.
La guerre d'indépendance
algérienne
La torture selon plusieurs sources (manuels,
wikipédia, L'histoire)
.
.
La guerre d'Algérie
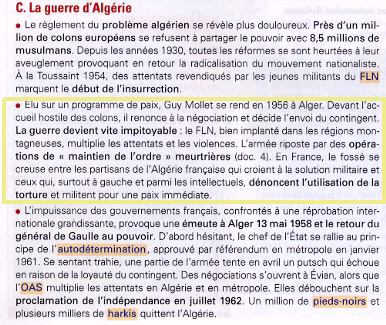
|
"La guerre devient impitoyable
: le FLN bien implanté dans les régions montagneuses, multiplie
les attentats et les violences. L'armée riposte par des opérations
de "maintien de l'ordre" très meurtrières. En France, le
fossé se creuse entre les partisans de l'Algérie française
qui croient à la solution militaire... et ceux qui dénoncent
l'utilisation de la torture..."
Nathan terminale 2004.
dans les documents, un texte
"Les rappelés témoignent", mars
1957
|
.
| 1954 - 1958 : l'enlisement dans
la guerre
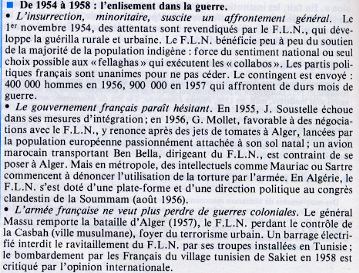
Istra terminale 1983
|
.
"Les difficultés de la décolonisation
: la France et le cas algérien"
sujet de bac 2004 : «
L'Algérie est française et le restera. Nous sommes des Français
et nous le resterons, nous ne céderons pas sur ce point et entrerons
en lutte contre le régime, s'il entend en disposer autrement ».
Les Algériens en lutte
pour leur indépendance ?
selon les documents proposés,
ce sont des rebelles, des gens
passés à la dissidence, des assassins, selon L’Echo d’Alger
(20-21 mai 1956),
"huit millions de musulmans non
assimilés" (Guy Mollet),
"Les Musulmans d'Algérie
veulent une patrie et ont choisi d'être français". (colonel
Bourgoin)
Document 1 : Déclaration
de Guy Mollet, président du Conseil.
Document 2 : Extrait de la une
de L'Écho d'Alger, 20-21 mai 1956.
Document 3 : Le point de vue, en
1958, d'un Français né en Algérie.
Document 4 : Discours du général
de Gaulle.
Document 5 : Extrait de la une
du Figaro, 19 mars 1962.
http://perso.wanadoo.fr/bac-es/bac2004_histoire03_sujet.html
|
.
Les débuts de la guerre d'Algérie
(Bordas, terminale 1983)
[...] Face à
la montée de la guerre et des violences, l’opinion se divise. On
trouve des partisans de la présence française en Algérie
dans la plupart des courants politiques. Mais la défense de l’"
Algérie française" est surtout le fait de la droite qui dénonce
la " trahison" des hommes politiques Michel Debré prétend
que la victoire en Algérie passe par le renversement du régime.
Des manifestations, souvent organisées par des groupes d’extrême
droite, parfois fascisants. comme Jeune Nation, appellent à l’extermination
des "rebelles" et de leurs " complices ". En revanche, des intellectuels
de gauche, chrétiens comme François Mauriac, progressistes
comme Jean-Paul Sartre, engagent gent une campagne humanitaire contre la
torture. Les communistes ne sont pas les seuls à réclamer
la paix immédiate en Algérie. Des hebdomadaires comme l’Express,
France-Observateur, des revues comme Esprit, réclament
une solution négociée et libérale. Mais, aussi bien
en France qu’en Algérie, ces libéraux" sont poursuivis par
les autorités. Quelques-uns s’engagent même au côté
du F.L.N. [...]
L'ensemble
du texte
|
.
La guerre d'Algérie
dans Wikipédia en français (extrait):
À partir de 1954, le combat
armé pour l'indépendance de l'Algérie se traduit par
des exactions contre les populations civiles d'origine européenne
et arabe ainsi que par une guérilla, des maquis et des affrontements
avec l'armée française, qui comprend également des
unités de supplétifs musulmans appelés " Harkis ".
Le FLN se radicalise rapidement et utilise le terrorisme. Les civils européens
et arabes sont très tôt pris pour cible dans des attentats
terroristes ou des massacres comme à El Alia. Les représailles
de l'armée sont extrêmement dures, avec notamment des opérations
de renseignement impliquant le recours à la torture. Les militaires
tortionnaires justifiaient l'utilisation de la torture comme étant
un moyen d'endiguer les attentats, notamment pendant la bataille d'Alger.
Dans le même temps le FLN s'attaque férocement à toutes
les autres organisations nationalistes. En réaction au terrorisme
du FLN, l'OAS mène une campagne d'attentats terroristes, surtout
pendant quelques mois entre février 1961 et juin 1962. Cette campagne
contre-terroriste se termine par un affrontement avec l'armée française
et un attentat contre le général De Gaulle (le Petit Clamart).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d'Alg%C3%A9rie
|
.
| Algerian war of independance :
Deux paragraphes extraits d'un long article
dans la version en anglais :
To increase international and domestic
French attention to their struggle, the FLN decided to bring the conflict
to the cities and to call a nationwide general strike. The most notable
manifestation of the new urban campaign was the Battle of Algiers, which
began on September 30, 1956, when three women placed bombs at three sites
including the downtown office of Air France. The ALN carried out an average
of 800 shootings and bombings per month through the spring of 1957, resulting
in many civilian casualties and inviting a crushing response from the authorities.
The 1957 general strike, timed to coincide with the UN debate on Algeria,
was imposed on Muslim workers and businesses. General Jacques Massu, who
was instructed to use whatever methods were necessary to restore order
in the city, frequently fought terrorism with acts of terrorism. Using
paratroopers, he broke the strike and systematically destroyed the FLN
infrastructure there. But the FLN had succeeded in showing its ability
to strike at the heart of French Algeria and in rallying a mass response
to its appeals among urban Muslims. Massu's troops punished villages that
were suspected of harboring rebels by attacking them by mobile troops or
aerial bombardment (reminiscent of Nazi tactics against French Resistance)
and gathered 2 million of rural population to concentration camps. Moreover,
the publicity given the brutal methods used by the army to win the Battle
of Algiers, including the widespread use of torture, cast doubt in France
about its role in Algeria. Pacification had turned into a colonial war.
[...]
The French military command ruthlessly
applied the principle of collective responsibility to villages suspected
of sheltering, supplying, or in any way cooperating with the guerrillas.
Villages that could not be reached by mobile units were subject to aerial
bombardment. The French also initiated a program of concentrating large
segments of the rural population, including whole villages, in camps under
military supervision to prevent them from aiding the rebels — or, according
to the official explanation, to protect them from FLN extortion. In the
three years (1957–60) during which the regroupement program was followed,
more than 2 million Algerians were removed from their villages, mostly
in the mountainous areas, and resettled in the plains, where many found
it impossible to reestablish their accustomed economic or social situations.
Living conditions in the camps were poor. Hundreds of empty villages were
devastated, and in hundreds of others orchards and croplands were destroyed.
These population transfers apparently had little strategic effect on the
outcome of the war, but the disruptive social and economic effects of this
massive program continued to be felt a generation later. [...]
http://en.wikipedia.org/wiki/Algerian_War |
.
Raphaëlle Branche - Torture : la République
en accusation
L’histoire, Les collections n° 15 - 2002
(extraits)
- La contre-terreur selon Lacheroy
- En 1959, le départ du
général Salan n’est pas pour autant synonyme de la fin de
la torture. Des hommes comme le colonel Lacheroy sont certes invités
à quitter l’Algérie, mais les objectifs définis par
Robert Lacoste dès 1956 - l'anéantissement des groupements
militaires et la destruction de la structure politique de l’adversaire
- restent inchangés. Le générai Challe ne modifie
en rien les méthodes employées pour obtenir des renseignements
et, plus généralement, pour terroriser la population. Au
contraire.
http://clioweb.free.fr/dossiers/algerie/branche.htm
R Branche La torture et l'armée
pendant la guerre d'Algérie (1954-1962) Gallimard 2001
La guerre d'Algérie :
une histoire apaisée Points 2005 |
.
DL 02/2006 |